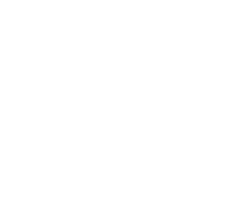Rue Etienne Dolet
Rue étroite du vieux Chablis contournant la Collégiale Saint Martin entre la rue Ernest Renan et la place du Regain et la rue Abbé Duchâtel.
Etienne Dolet
Etienne Dolet, né le 3 aout 1509 à Orléans et mort le 3 aout 1546 à Paris à l’âge de 37 ans, est un écrivain, poète, imprimeur, humaniste et philosophe.
Une tradition douteuse fait de lui un fils illégitime du roi François 1er, mais il est certain qu’il est issu d’une famille de haut rang. En 1521 il part pour Paris, ou il étudie pendant cinq ans auprès d’un prestigieux professeur.
Au service d’un ambassadeur de France à la République de Venise il se rend en Italie en 1530, il publie durant cette période ses premiers poèmes d’amour en latin. De retour en France vers 1531, il étudie le droit et la jurisprudence à l’université de Toulouse mais il est impliqué, par son humeur turbulente, dans de violentes disputes entre étudiants. Il est emprisonné et malgré ses protections il est banni par le parlement de Toulouse en 1534.
Grâce à un imprimeur, il publie ses premiers ouvrages en latin. Un de ses ouvrages est dédié à François 1er qui lui accorde pour dix ans le privilège d’imprimer tous types d’ouvrages. Il obtient également une grâce dans une sombre affaire d’assassinat contre lui. Il s’installe imprimeur à Lyon.
Il se met au travail et édite Galien, Rabelais, Marot. Il n’ignore pas les dangers auxquels il s’expose. Cela se voit non seulement par le ton de ses textes mais également par le fait qu’il a essayé d’abord de se concilier ses adversaires en publiant un ouvrage ou il faisait sa profession de foi. Cette catholicité de façade transparait dans un grand nombre de ses ouvrages publiés. Mais avant que son autorisation d’imprimer n’expire, il s’attire à Lyon de nouvelles difficultés par son caractère satirique et par la publication d’ouvrages entachés d’hérésies. Ses ennemis le font emprisonner en 1542 sous l’accusation d’athéisme. Après un séjour en prison de quinze mois il est relâché grâce à l’intervention de l’évêque de Tulle, Pierre Duchâtel. Emprisonné une seconde fois en 1544, il s’échappe en Italie dans le Piémont.
Pensant qu’il peut en appeler à la justice du roi de France, de la reine de Navarre et du Parlement de Paris, il revient imprudemment en France. Il est nouveau arrêté et jugé « athée évadé » par la faculté de théologie de la Sorbonne. François 1er qui l’avait d’abord protégé, l’abandonne. Il est amené à Lyon pour y subir son supplice. Il implore le pardon de Dieu, ce qui lui vaut de ne pas avoir la langue coupée avant la mise à feu de son bucher. Le 3 aout 1546, il est étranglé puis son corps est brulé avec ses livres sur la place Maubert. Son crime était selon les uns, d’avoir professé le matérialisme et l’athéisme, selon les autres de s’être montré favorable aux opinions du réformateur protestant Martin Luther.
Plusieurs statues d’Etienne Dolet ont été érigées mais elles ont été fondues au cours de la dernière guerre. Un nouveau monument a été inauguré en 1955 à Orléans, dans le jardin de l’Hôtel-Groslot.
De très nombreuses villes ont donné le nom d’Etienne Dolet à l’une de leurs rues. Orléans a donné son nom à un collège ainsi que Provins. Une loge maçonnique, porte son nom, La Respectable Loge Etienne Dolet, Orient d’Orléans, Grand Orient de France.